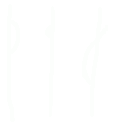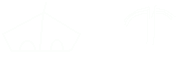|
Les
signes de type Placard dans l'art préhistorique
Les
grottes préhistoriques ornées sont surtout célèbres
pour les magnifiques animaux qu'ont peints nos ancêtres. Et maintenant
que les grottes de Lascaux et d'Altamira sont fermées au public,
et qu'il n'a pas accès à la grotte Chauvet ou à la
grotte Cosquer découvertes dans les années 1990, il est
indispensable que les amoureux de l'art paléolithique aillent admirer
ces deux autres joyaux que sont les grottes de Niaux (Ariège) et
du Pech-Merle (Lot).
De
quand date l'art préhistorique ?
L'art semble avoir débuté par la fabrication de décorations
corporelles (perles, pendentifs), il y a 40 000 ans en Europe, et
quelques dizaines de millénaires plus tôt en Afrique. Ce
n'est qu'il y a 30 ou 35 000 ans qu'en plusieurs endroits du monde
(Afrique, Australie, Eurasie) apparaissent la sculpture et l'art rupestre.
Qui
est l'artiste préhistorique ?
En dehors des pendentifs de la culture châtelperronnienne et du
masque de pierre de la Roche-Cotard, qui sont des produits de l'Homme
de Neandertal, toutes les autres œuvres artistiques connues de la
préhistoire sont le fruit de l'Homme moderne. Plusieurs civilisations
se sont succédées (ou chevauchées) tout au long de
la longue période appelée Paléolithique supérieur
(de 40 000 avant le présent à 10 000 avant le
présent) : atérienne, stillbayenne (Afrique), de Ngandong,
de l'Ordos, de l'Angara (Asie), aurignacienne, pavlovienne, magdalénienne
(Europe), etc.
Que
dessine l'artiste préhistorique ?
L'art préhistorique a conservé un même schéma
global durant tout le Paléolithique. L'Homme a dessiné,
peint et gravé des animaux, des hommes et des signes. Une des constantes
de cet art est d'être en partie localisé dans les profondeurs
des grottes, là où l'Homme n'habitait pas. Il vivait en
effet dans des huttes hors des grottes ou parfois protégées
à l'entrée des grottes. Il gravait parfois sur les parois
extérieures et à l'entrée des grottes. Mais surtout
il allait, pendant 30 000 ans, dessiner et graver dans l'obscurité,
à plusieurs centaines de mètres de l'entrée, éclairé
seulement par des torches ou des lampes à graisse peu efficaces.
Il a dessiné, parfois avec un art extraordinaire, de nombreux animaux
: des dangereux, qu'il ne chassait pas, et aussi des moins dangereux.
Il a quelquefois dessiné, ou plutôt esquissé, des
êtres humains, et des morceaux d'humains (mains, profils, silhouettes).
Et aussi des êtres composites, mi-animaux, mi-humains : ils sont
rares mais intéressants. Enfin, et surtout, l'Homme préhistorique
a peint ou gravé des signes. C'est ce qu'il a laissé en
plus grand nombre.
Pourquoi
l'art ?
On a d'abord pensé que l'objectif était purement esthétique
: l'art pour l'art ! Mais pourquoi alors cacher ses œuvres dans les
profondeurs de la terre ? D'autres ont émis l'hypothèse
du totémisme : mais les ancêtres mythiques animaux auraient
alors toujours été représentés sous la même
forme, ce qui n'est pas le cas. Puis certains, comme l'abbé Henri
Breuil, ont développé la thèse de la magie de la
chasse. Mais il est prouvé que nulle part ce soit l'animal le plus
chassé qui soit le plus représenté… Délaissant
le pourquoi, André Leroi-Gourhan a voulu expliqué le comment
: il a montré que les œuvres paléolithiques ont toujours
une même structure dans leur élaboration ( tel animal à
l'entrée, tel autre plus en profondeur, celui-ci toujours ou souvent
associé avec celui-là, …), en relation avec le contenu
mythologique que transmet l'art préhistorique. Enfin, récemment,
Jean Clottes a de nouveau proposé une origine chamanique des œuvres
d'art paléolithiques.
Les
signes.
Les très nombreux signes peuvent être regroupés en
plusieurs types. Citons pour l'Europe, des plus simples aux plus construits
: les points et groupes de points, les bâtonnets et tirets, les
signes angulaires, les signes barbelés, les signes en crochet,
les signes ovales, les signes triangulaires, les signes quadrangulaires,
les signes éléviformes, les signes claviformes, les signes
en accolade ( { ) , les signes tectiformes (en forme de toit) et
les signes aviformes (en forme d'oiseau). Ces signes représentent
des faits ou des mythologies connus de l'Atlantique à l'Oural.
Certains signes identiques se retrouvent à des centaines de kilomètres
les uns des autres : ainsi les signes claviformes existent-ils en Ariège
(Le Portel, grotte des Trois-Frères, Niaux, Le Tuc-d'Audoubert
et Fontanet) mais aussi à Lascaux (Périgord) et en Espagne
(Le Cullalvera en Cantabrique et à Píndal dans les Asturies).
Les
signes de type Placard.
De même, des signes qu'on a d'abord cru spécifiques du Lot
ont été découverts jusqu'à 500 km de là
: les signes de type Placard sont aujourd'hui connus dans la grotte du
Pech-Merle (Lot), de Cougnac (Lot), du Placard (Charente) et dans la grotte
Cosquer (Bouches-du-Rhône). Deux signes de la grotte de Lascaux
leur ressemblent fortement. Ce signe a été diversement décrit
: tectiforme, aviforme, en accolade, à cheminée, en forme
d'albatros. Jean Clottes les appelle signes de type Placard pour trois
raisons : parce que c'est dans la grotte du Placard qu'ils sont les plus
nombreux et les mieux datés, et afin que la terminologie reste
descriptive sans tenter d'expliquer la signification du signe.
Datation.
Dans la grotte du Placard, les signes ont été gravés
dans un niveau archéologique dans lequel ont été
découverts des outils de la civilisation solutréenne. Un
os brûlé fiché dans une anfractuosité au-dessus
de gravures a été daté par la technique du carbone
14 à 19970 BP (19970 avant le présent), ce qui confirme
leur attribution au Solutréen. Combier trouve des affinités
entre les deux grottes du Lot et la grotte de la Tête du Lion qui
est datée de 21600 BP (mais Leroi-Gourhan et Michel Lorblanchet
estiment que les deux grottes du Lot sont plus récentes que Le
Placard). Enfin, les œuvres de la grotte Cosquer datent de deux périodes,
dont l'une (19000 à 18000 BP) correspond aux dates des autres signes
du Placard. Toutes ces dates concordent donc pour dater notre signe du
début ou du milieu du Solutréen, autour de 20000 BP. Il
subsiste le problème de Lascaux : le carbone 14 donne quatre dates
: 15500, 16000, 17200 et récemment 18600 BP. Les dernières
analyses stylistiques comparatives attribuent les productions de Lascaux
à la fin du Solutréen (Norbert Aujoulat), ce qui est en
faveur du rapprochement des deux signes de Lascaux avec les signes de
type Placard.
Les
signes du Placard à Lascaux ?
Les deux " signes à cheminée " de Lascaux, le
premier (signe A ci-contre) dans la salle dite " l'Abside ",
le second (signe B) dans le " Diverticule axial ", sont-ils
des signes de type Placard ? Les arguments en faveur de cette hypothèse
sont la forme générale des signes avec leur cheminée
centrale (Denis Vialou, Norbert Aujoulat), l'existence d'une représentation
d'un homme blessé à tête d'oiseau dans le " Puits
" de Lascaux (Thierry Koltes, ci-contre), et l'association d'un des
signes avec un cheval (Koltes, ci-contre). Les arguments opposés
sont que le premier signe n'a pas été tracé en une
seule fois (Aujoulat) et que le second est différent des autres
signes du Placard par sa taille, sa forme générale et la
technique utilisée (Clottes) ; la datation n'infirme plus l'hypothèse
depuis qu'un fragment de sagaie trouvé par Breuil au pied de la
Scène du Puits a été daté en 1998 à
18600 BP. La spécificité, la rareté et l'originalité
des signes de type Placard incitent Leroi-Gourhan et Clottes à
donner aux signes du Placard une extension modérée dans
le temps : seulement "quelques générations (une seule
peut-être)" dit Leroi-Gourhan.
Que
nous apprennent ces signes ?
La spécificité, la rareté et l'originalité
des signes de type Placard nous assurent qu'il s'agit bien du même
signe que l'on retrouve au Pech-Merle, à Cougnac, au Placard et
à Cosquer. On apprend ainsi que les signes peuvent circuler sur
de très grandes distances, à l'instar des techniques et
des sculptures. Mais sont-ils les produits d'un artiste unique, ou d'une
seule tribu, ou d'une même culture ? Son extension est-elle due
à la migration de ses créateurs, ou alors fut-il transmis
à une tribu par une autre ?
Que
racontent ces signes ?
Au Pech-Merle, un signe du Placard surmonte un homme à tête
d'oiseau transpercé de plusieurs traits. A Cougnac, la paroi de
la grotte comprend onze signes du Placard à une extrémité
et, plus loin, le dessin de deux hommes (l'un à tête d'oiseau)
percés de traits. La grotte Cosquer contient elle aussi la gravure
d'un homme blessé. A Lascaux, on l'a vu, il y a également
une représentation d'un homme blessé à tête
d'oiseau. Ce thème est assez rare pour ne pas être par hasard
associé aux signes de type Placard. Dans la grotte du Placard,
les signes sont associés à des animaux, principalement des
chevaux (cf. le cheval de Lascaux). Quelle histoire racontent ces associations
de dessins ? Quels sont les thèmes, les concepts, les croyances
contenus dans ces signes ? Que peut-on retracer des rituels observés
au fond des grottes ? Au moins une certitude : la stalagmite située
devant le second homme blessé de Cougnac a très souvent
servi d'instrument à percussion et en a gardé la trace.
Cougnac fut un lieu de culte très fréquenté. Le Pech-Merle
par contre fut un sanctuaire qui ne reçut que de rares visiteurs.
On peut ajouter que les signes du Placard ne sont pas l'apanage exclusif
de tels endroits sacrés, puisqu'au Placard, ils décorent
le lieu d'habitat. Nous connaissons ce phénomène encore
à notre époque, puisque les symboles religieux ne se limitent
pas à la décoration des temples et des églises, mais
s'observent également dans les demeures des croyants.
|
|
|
|
Les
signes du Placard et les signes similaires*.
Christian Züchner a mis ci-dessus en évidence la ressemblance
entre plusieurs signes : les signes en forme de papillon ou d'oiseau de
la grotte Chauvet (31000 BP ?*), le signe
en forme de seins ou de cœur du Portel, les deux bas-reliefs de Roc
de Vézac (Dordogne) et les pendentifs gravettiens en ivoire de
Dolní Vestonice (Moravie). En plus, au moins l'un des signes de
Chauvet se rapproche des tracés rouges de La Pasiega (Nord de l'Espagne).
Pour Züchner, les " papillons " de Chauvet sont peut-être
les prédécesseurs* réalistes
des signes de type Placard. Il est indéniable que la forme générale
des "papillons" de Chauvet rappelle les signes de type Placard.
Mais c'est également le cas d'un magnifique pendentif de Dolní
Vestonice qui selon Vialou est un exemple exceptionnel de l'association
de symboles des deux sexes (ci-contre). Je trouve que parmi les signes
à rapprocher de ceux du Placard, il ne faut oublier ni les signes
en accolade peints à Altamira et à El Castillo, ni l'étonnante
"inscription" découverte dans la grotte de La Pasiega.
J'observe également que les deux cercles échancrés
en bas-relief de Vézac sont semblables à trois disques échancrés
présents au Pech-Merle, comme si tous ces lieux avaient plus d'un
point commun. Dépassant le cadre du Paléolithique, Paul
Tréhin a noté la ressemblance des signes du Placard avec
les signes corniformes de la Vallée des Merveilles (région
du Mont Bégo, Alpes-Maritimes) datant de l'âge du Bronze
et représentant des bovidés (Henry de Lumley) ou des personnages
en position d'orant. Zaf nous rapporte quant à lui des représentations
de chauves-souris datant de 100 av. J.-C. à 1600 apr. J.-C. et
évoquant les signes du Placard et les aviformes.
L'hypothèse sexuelle.
Pour Leroi-Gourhan, les signes en accolade (comme il appelait les signes
de type Placard) sont des signes bêta, qu'il a initialement fait
correspondre au sexe féminin, dont des équivalents sont
les dessins de blessures. Les traits, notamment ceux qui traversent les
hommes blessés que nous avons observés, sont des signes
alpha, masculins. L'association des signes du Placard et des traits blessant
les hommes renouvellerait ainsi la dyade alpha-bêta de Leroi-Gourhan.
Parmi les signes qui ressemblent le plus aux "papillons" de
Chauvet, j'ai noté que plusieurs sont des signes féminins
: les figurines de Dolní Vestonice représentant des femmes
et des seins, le signe en forme de seins de la grotte du Portel. A moins
que ces pendentifs unissent les symboles des deux sexes. Züchner
précise cependant que " la pensée paléolithique
est bien plus complexe qu'une dyade masculin - féminin, et affirmer
que les signes du Placard ne représentent que la féminité
ne serait qu'une partie de la vérité. "
En conclusion (temporaire…)
Les études actuelles sur l'art paléolithique sont plus prudentes
et moins dogmatiques qu'au siècle dernier. Elles se contentent
souvent d'être descriptives, mais avec précision et exhaustivité.
Nous retiendrons donc surtout les associations du signe du Placard avec
le thème de l'homme blessé (souvent à tête
d'oiseau) et avec le dessin du cheval ; si les signes alpha et bêta
ne sont pas sexuels, ils sont cependant à renvoyer à l'association
du signe du Placard avec l'homme blessé. Je relève également
la ressemblance du signe du Placard avec les silhouettes des hommes-fantômes
de Cougnac. Enfin, je ne peux m'empêcher de relever la coïncidence
sémantique des têtes d'oiseau et des signes aviformes
(en forme d'oiseau).
Résumé
Plusieurs groupes géographiquement éloignés, certainement
des Solutréens, ont peint et gravé un signe mystérieux
depuis la Charente jusqu'à la côte méditerranéenne.
Ce signe a peut-être été reproduit pendant un à
trente siècles. Il constitue peut-être une réminiscence
de figures plus réalistes remontant à l'Aurignacien*.
Il démontre que des groupes différents vivant sur des territoires
distants de plusieurs centaines de kilomètres ont entretenu des
relations plus ou moins suivies. La signification de ce signe, peut-être
féminin ou bisexué, parfois associé à des
chevaux ou à des humains en danger, et dessiné aussi bien
dans des habitats que dans des sanctuaires, restera sans doute à
jamais inconnue.
BIBLIOGRAPHIE
[ *Même
s'il leur trouve des similitudes morphologiques et chronologiques, Züchner
distingue cependant le groupe de type Placard des autres types de signes
(Chauvet, Le Portel, La Pasiega etc.). Selon lui, "tous ces signes
datent de la fin du Gravettien, du Solutréen surtout, et du Badegoulien.
Aucun n'est en tout cas postérieur au Magdalénien III."
La date aurignacienne de 31 000 BP attribuée à Chauvet
concerne-t-elle aussi les papillons ou ceux-ci sont-ils plus récents
?]
|
|
|